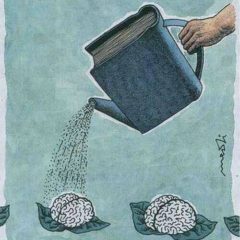J’ai écrit ce texte en 2018.
Il a été ma douleur depuis que mes parents ont divorcé, quand j’avais neuf ans.
Je ne voulais pas le quitter, pas plus que notre maison, notre ville, mon école, mes copains copines.
Je le trouvais faible, j’ai eu honte de lui. Et j’ai eu honte de moi d’avoir honte de lui.
Je voulais l’aider mais j’étais sa fille; c’était mon besoin mais pas le sien, lui il allait bien.
Je trouvais qu’il ne m’avait rien appris mais c’est moi qui n’avait rien compris.
J’ai réalisé depuis que derrière son silence, il y avait de la confiance et du respect.
J’avais des peurs que je n’ai pas su gérer, mais si je lui avais demandé, il m’aurait appris à nager, il le faisait si bien, comme marcher sur les mains.
Il ne me jugeait pas, il était fier de moi.
Il a perdu sa mère quand il avait trois semaines, ça fait court pour faire le plein d’amour !
Son père n’a pas su faire, pour lui et ses deux frères, alors c’est chez les orphelins d’Auteuil qu’il a trouvé accueil.
Apprenti boulanger puis la guerre d’Algérie, où il a vu tous ses copains se faire tuer, c’est en gros tout ce que je sais.
Il n’en a jamais parlé mais en a gardé fragilité, comme de bégayer quand il essayait de faire preuve d’autorité.
C’était un vrai gentil, jamais d’agressivité ni de compétitivité; simplement mauvais perdant à la belotte.
On ne savait pas quoi se dire, nos vies séparées étaient si peu actives qu’il n’y avait rien à en raconter, nous ne savions pas nous parler.
J’étais une fille casse-pieds, à toujours vouloir le bousculer, puis trop souvent éloignée, à ne plus oser l’aborder.
Le téléphone manquait et trop souvent hospitalisé, dans ces établissements qui vous gavent de médicaments, qu’il était douloureux de s’inquiéter de son état de santé.
Il nous a fait un sacré pied-de-nez en mourant un peu trop tôt, seul et sans prévenir. Mort un mercredi, nous l’apprenions par hasard le vendredi.
Il avait 58 ans, c’était en avril 1996.
Depuis il ne m’a plus quitté, je sais où il est, mais je ne sais en parler.
Isabelle Fornier